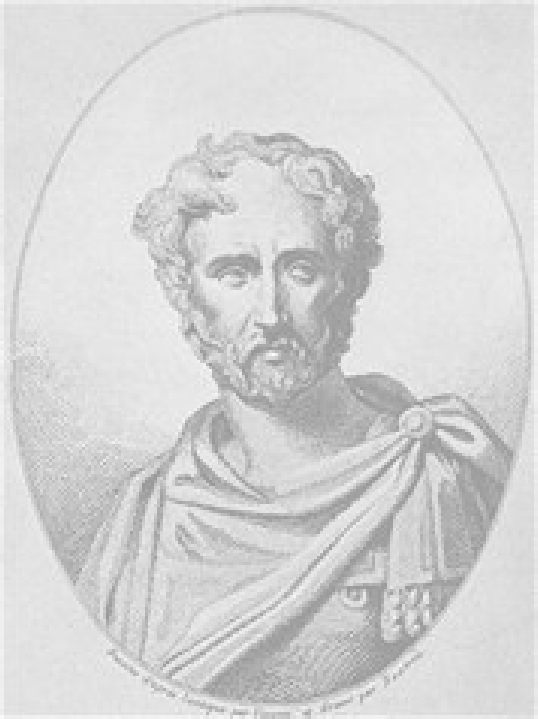
Ses intérêts
La philosophie : Comme beaucoup de gens cultivés du début de l'empire romain, Pline est adepte du stoïcisme. Il est lié avec son plus noble représentant, Publius Clodius Thrasea Paetus et subit aussi l'influence de Sénèque. Ce Stoïcien qui s'adonne à l'étude de la nature et dont la morale lui enseigne d'être agréable avec les autres, cherche sans cesse dans son œuvre littéraire à être bénéfique et à instruire ses contemporains (Praef. 16, XXVIII, 2 ; XXIX, I).
Il est aussi influencé par l'épicurisme, l'académisme et la renaissante école pythagoricienne. Mais sa vision de la nature et des dieux reste essentiellement stoïcienne. Selon lui, c'est la faiblesse de l'humanité qui enferme la déité sous des formes humaines entachées de fautes et de vices (II, 148). La divinité est réelle : c'est l'âme du monde éternel, dispensant sa bienfaisance tant sur terre que sur le soleil et les étoiles (II, 12 sqq., 154 sqq.). L'existence de la divine Providence est incertaine (II, 19) mais la croyance en son existence et à la punition des méfaits est salutaire (II, 26) ; et la récompense de la vertu consiste en l'élévation à la divinité de ceux qui ressemblaient à un dieu en faisant le bien pour l'humanité (II, 18, « Deus est mortali juvare mortalem, et haec ad aeternam gloriam via »). Il est mauvais de s'enquérir du futur et de violenter la nature en ayant recours aux arts de la magie (II, 114 ; XXX, 3) mais l'importance des prodiges et des présages n'est pas rejetée (II, 92, 199, 232).
La vision que Pline a de la vie est sombre : il voit la race humaine plongée dans la ruine et la misère (II, 24 ; VII, 130). Contre le luxe et la corruption morale, il se livre à des déclamations si fréquentes (comme celles de Sénèque) qu'elles finissent par lasser le lecteur. Sa rhétorique fleurit pratiquement contre des inventions utiles (comme l'art de la navigation) dans l'attente du bon sens et du goût (XIX, 6).
Avec l'esprit de fierté nationale du Romain, il combine l'admiration des vertus qui ont mené la république à sa grandeur (XVI, 14 ; XXVII, 3 ; XXXVII, 201). Il n'élude pas les faits historiques défavorables à Rome (XXXIV, 139) et même s'il honore les membres éminents des maisons romaines distinguées, il est libre de l'indue partialité de Tite-
Littérature et science : À la fin des ses travaux littéraires, en tant que seul Romain à avoir choisi comme thème l'entièreté du monde de la nature, il implore la bénédiction de la mère universelle sur tout son travail.
En littérature, il attribue la plus haute place à Homère et à Cicéron (XVII, 37 sqq.) puis en second lieu Virgile. Il a été influencé par les recherches du roi Juba II de Numidie et qu'il appelait « mon Maître »
Il voue un profond intérêt à la nature et aux science naturelles, les étudiant d'une manière nouvelle pour cette époque dans le monde romain. Malgré le peu d'estime que l'on porte pour ce genre d'études, il s'efforce toujours d'être au service de ses concitoyens (XXII, 15).
L'envergure de son œuvre est vaste et complète, une encyclopédie de toutes les connaissances et les arts tant qu'ils sont liés à la nature ou qu'ils en tirent leurs matériaux. Dans ce but, il étudie tout ce qui fait autorité dans chacun de ces sujets et ne manque pas d'en citer des extraits. Ses indices auctorum sont, dans certains cas, les autorités qu'il a lui-
Il est évident que quelqu'un qui passe tout son temps à lire, écrire et compulser des extraits de ses prédécesseurs, n'en a plus pour une pensée indépendante ou pour une observation expérimentale patiente des phénomènes naturels. Mais c'est sa curiosité scientifique pour les phénomènes de l'éruption du Vésuve qui amène sa vie d'étude infatigable à sa fin prématurée et toute critique de ses défauts d'omission est désarmée par la candeur de sa confession dans sa préface : « nec dubitamus multa esse quae et nos praeterierint ; homines enim sumus et occupati officiis ».
Son style trahit une influence de Sénèque. Il vise moins à la clarté qu'à l'épigramme. Il est plein d'antithèses, de questions, d'exclamations, de tropes, de métaphores, et d'autres maniérismes de l'âge d'argent de la littérature romaine (deux premiers siècles). La forme rythmique et artistique de la phrase est sacrifiée à une passion pour l'emphase qui enchante par le report de l'argument vers la fin. La structure de la phrase est aussi souvent erratique et décousue. On note aussi une utilisation excessive de l'ablatif absolu et des phrases à l'ablatif sont souvent mises en apposition pour exprimer l'opinion de l'auteur sur un énoncé qui précède immédiatement. Par exemple : XXXV, 80, « dixit (Apelles) ... uno se praestare, quod manum de tabula sciret tollere, memorabili praecepto nocere saepe nimiam diligentiam ».
Vers le milieu du IIIe siècle, un résumé des parties géographiques de l'œuvre de Pline est réalisé par Solinus et au début du IVe siècle, les passages médicaux sont réunis dans les Medicina Plinii. Au début du VIIIe siècle, Bède le Vénérable posséde un manuscrit de toute l'œuvre. Au IXe siècle, Alcuin envoie à Charlemagne un exemplaire des premiers livres (Epp. 103, Jaffé) et Dicuil réunit des extraits des pages de Pline pour sa Mensura orbis terrae (C, 825).
Les travaux de Pline sont tenus en grande estime au Moyen Âge. Le nombre de manuscrits restants est d'environ 200, mais le plus intéressant d'entre les plus anciens, celui de Bamberg, ne contient que les livres xxxii à xxxvii. Robert de Cricklade, supérieur de St Frideswide à Oxford, adresse au roi Henry II un Defloratio, contenant neuf volumes de sélections prises d'un des manuscrits de cette classe et qui est, depuis peu, reconnu comme donnant parfois la seule indication valable du texte initial. Parmi les manuscrits plus anciens, les codex Vesontinus, jadis à Besançon (XIe siècle), sont séparés en trois parties, désormais une à Rome, une à Paris, et la dernière à Leiden (où il existe aussi une transcription du manuscrit total).
Des ouvrages de Pline un seul est arrivé jusqu'à nous, son Histoire naturelle. Ce n'est pas, à proprement parler, ce que dans notre langage moderne nous entendrions par un titre semblable. Voici le plan de ce livre : l'auteur commence par exposer des notions sur le monde, la terre, le soleil, les planètes, et les propriétés remarquables des éléments. De là il passe à la description géographique des parties de la terre connues des anciens. Après la géographie vient ce que nous appellerions l'histoire naturelle, à savoir, l'histoire des animaux terrestres, des poissons, des insectes et des oiseaux. La partie botanique qui suit est très considérable, d'autant plus que Pline introduit beaucoup de renseignements sur les arts, tels que la fabrication du vin et de l'huile, la culture des céréales, et différentes applications industrielles. La partie botanique terminée, il revient sur les animaux pour énumérer les remèdes qu'ils fournissent ; enfin il passe aux substances minérales, et là (ce qui est une des parties les plus intéressantes de son livre) il fait à la fois l'histoire des procédés d'extraction de ces substances, et celle de la peinture et de la sculpture chez les anciens. On voit qu'à vrai dire l'ouvrage de Pline est une sorte d'encyclopédie.
Œuvres : Pline le Jeune dans une de ses lettres cite toutes ses œuvres.
« Je suis très heureux que la lecture des livres de mon oncle vous passionne au point de vouloir les posséder tous et d'en réclamer la liste complète. Je remplirai le rôle de catalogue et même je vous indiquerai l'ordre de leur composition, car cette connaissance ne déplaît pas non plus aux curieux de lettres.
L'Art de lancer le javelot à cheval (en 1 livre) : il l'a composé avec autant de talent que de soin, lorsqu'il était aux armées comme commandant d'une aile de cavalerie.
La Vie de Pomponius Secundus (en 2 livres) : il en était particulièrement aimé ; il écrivit cet ouvrage comme pour s'acquitter d'une dette envers la mémoire de son ami.
Les Guerres de Germanie (en 20 livres) : il y a raconté toutes les guerres que nous avons soutenues contre les Germains. Il les commença pendant son service en Germanie ; un songe lui en donna l'idée ; pendant son sommeil il vit debout devant lui le fantôme de Drusus Néron, qui, après avoir soumis une grande partie de la Germanie, y mourut ; il lui recommandait de veiller sur sa mémoire et le priait de le sauver d'un injurieux oubli.
L'Homme de lettres (en 3 livres, divisés en 6 volumes à cause de leur étendue) : il y prend l'orateur au berceau et le conduit à sa perfection.
Les Difficultés de la grammaire (en 8 livres) : il l'écrivit pendant les dernières années du règne de Néron, quand tous les genres d'études un peu libres et un peu sérieuses eurent été rendues périlleuses par la servitude.
La Suite d'Aufidius Bassus (en 31 livres).
L'Histoire naturelle (en 37 livres) : ouvrage étendu, savant, presque aussi varié que la nature elle-